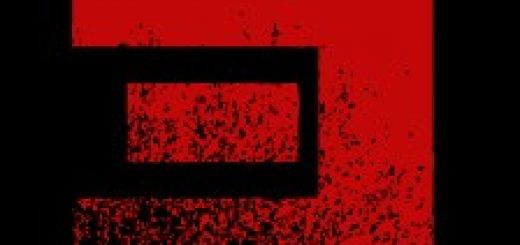FROID Texte de FRANCIS DENIS
Froid.
Le ciel est noir et sans étoiles.
Maman est partie.
M’a laissé seul au pied de cette immense porte où j’entends siffler le vent.
Mes yeux ont mal d’avoir pleuré.
Je gigote à peine, coincé dans la raideur du drap. Ma bouche est sèche.
Je cherche désespérément mon doudou.
Maman est partie.
M’a laissé seul au pied de cette immense porte où j’entends siffler le vent.
Mes yeux ont mal d’avoir pleuré.
Je gigote à peine, coincé dans la raideur du drap. Ma bouche est sèche.
Je cherche désespérément mon doudou.
Froid.
Disparu !
Vilain doudou…
Disparu !
Vilain doudou…
Cela fait sans doute quelques années, voire une décennie, que je vis cloîtré au fond de cette armoire, caché comme un trésor ou comme une monstruosité, qui sait ?
Elles sont revêtues d’une longue robe brune, lacée à la taille par une simple corde de lin. Elles portent sur la tête une espèce de cornette blanche qui dissimule la moitié de leur visage. Elles ont souvent la tête baissée et marchent à petits pas, telles des geishas silencieuses.
Celle qui ose rompre le silence de sa voix ferme et rude, doit être la supérieure, celle qui détient les clefs et ordonne les règles.
Elles sont revêtues d’une longue robe brune, lacée à la taille par une simple corde de lin. Elles portent sur la tête une espèce de cornette blanche qui dissimule la moitié de leur visage. Elles ont souvent la tête baissée et marchent à petits pas, telles des geishas silencieuses.
Celle qui ose rompre le silence de sa voix ferme et rude, doit être la supérieure, celle qui détient les clefs et ordonne les règles.
Elles se relaient pour venir ouvrir les portes et me sortir de ma cachette.
Elles semblent toutes attendre ce moment avec impatience. Je sens une certaine fébrilité dans leurs gestes et leurs façon de m’observer pendant la promenade. Elles murmurent et leurs yeux me cherchent furtivement dans l’ombre des arcades.
Elles semblent toutes attendre ce moment avec impatience. Je sens une certaine fébrilité dans leurs gestes et leurs façon de m’observer pendant la promenade. Elles murmurent et leurs yeux me cherchent furtivement dans l’ombre des arcades.
L’une d’entre elles, Marie, m’a construit un petit chariot. Je m’y accroche comme je peux, mes bras posés sur les planches qui me protègent et m’empêchent de tomber. Les roues couinent sur les grandes dalles de pierre et nos rires fleurissent comme des bouquets insolites sous les voûtes, autour du jardin parsemé de roses.
Elle me tire en courant et c’est comme sous la caresse du vent. Un drôle de manège sans pompon ni maman pour me regarder.
Que des morceaux blancs dans le bleu du ciel, un peu de coton, encadré par des rangées de tuiles longues, arrondies, usées par le temps et la pluie. Et tout cela tourne et tourne et tourne…
Que des morceaux blancs dans le bleu du ciel, un peu de coton, encadré par des rangées de tuiles longues, arrondies, usées par le temps et la pluie. Et tout cela tourne et tourne et tourne…
Parfois, certains soirs, je peux manger en leur compagnie.
Assis au bout de la grande table, je suis face à celle qui ordonne et à qui tout le monde obéit.
Le pain, le lait, les fruits… tout me semble merveilleux et c’est à chaque fois une fête, un bonheur immense qui s’empare de moi.
Assis au bout de la grande table, je suis face à celle qui ordonne et à qui tout le monde obéit.
Le pain, le lait, les fruits… tout me semble merveilleux et c’est à chaque fois une fête, un bonheur immense qui s’empare de moi.
C’est Marie, elle seule, qui me tient la cuillère, dépose les bouchées au creux de mes lèvres, sur ma langue et me sourit.
Dans ces moments bénis, il m’est donné la joie de pouvoir contempler la totalité de son visage et la clarté de son regard. Un regard tout en douceur et en amour. Un regard qui me fait prendre conscience du vide immense qui est en moi mais qui grignote toujours un peu plus d’espace pour me réchauffer le cœur et l’âme.
Dans ces moments bénis, il m’est donné la joie de pouvoir contempler la totalité de son visage et la clarté de son regard. Un regard tout en douceur et en amour. Un regard qui me fait prendre conscience du vide immense qui est en moi mais qui grignote toujours un peu plus d’espace pour me réchauffer le cœur et l’âme.
Lorsqu’elles passent près de moi, elles n’oublient jamais de se signer. Sans doute pour me saluer et me souhaiter une bonne nuit. Elles n’ont cependant pas l’air d’être très rassurées, comme si je les forçais à braver les interdits et que ma présence tenait du sacrilège.
Je ne sais trop quoi penser…
Il me semble pourtant qu’elles éprouvent une certaine affection pour moi. Bien sûr, pas aussi avérée que celle de Marie, mais il y a de la bienveillance dans leurs gestes et l’entrain qu’elles mettent pour me manipuler.
La peur n’y est pour rien, j’en suis sûr. J’en mettrais ma main à couper si seulement j’en avais une.
Je ne sais trop quoi penser…
Il me semble pourtant qu’elles éprouvent une certaine affection pour moi. Bien sûr, pas aussi avérée que celle de Marie, mais il y a de la bienveillance dans leurs gestes et l’entrain qu’elles mettent pour me manipuler.
La peur n’y est pour rien, j’en suis sûr. J’en mettrais ma main à couper si seulement j’en avais une.
Moi, ce que je n’aime pas, c’est quand on me repose dans l’armoire et qu’on referme les portes sur ma nuit, ma solitude, ma peur du vide.
J’ai mon cœur qui se met à battre la chamade et les veines de mon front gonflent jusqu’à ce que mes larmes mouillent mon corps et la poussière des planches qui me portent.
Je voudrais hurler, hurler pour que l’on m’entende jusqu’au bout du monde. Ma bouche s’ouvre alors démesurément mais aucun son n’en jaillit. Je ne suis plus qu’un morceau vivant qui se fait pipi dessus.
Demain, j’aurais la honte ; la honte et la rage.
Je maudirai celui qui nous a créé et je n’oserai pas regarder Marie dans les yeux.
J’espère qu’une autre la remplacera et que je n’aurais pas ainsi à la faire souffrir.
J’ai mon cœur qui se met à battre la chamade et les veines de mon front gonflent jusqu’à ce que mes larmes mouillent mon corps et la poussière des planches qui me portent.
Je voudrais hurler, hurler pour que l’on m’entende jusqu’au bout du monde. Ma bouche s’ouvre alors démesurément mais aucun son n’en jaillit. Je ne suis plus qu’un morceau vivant qui se fait pipi dessus.
Demain, j’aurais la honte ; la honte et la rage.
Je maudirai celui qui nous a créé et je n’oserai pas regarder Marie dans les yeux.
J’espère qu’une autre la remplacera et que je n’aurais pas ainsi à la faire souffrir.
On m’a lavé, changé, arrosé d’une eau parfumée, déposé dans mon chariot décoré pour l’occasion d’un cerceau fleuri.
Elles sont toutes venues se poser en cercle autour de Marie et la Mère s’est avancée.
Une chaîne autour du cou et un livre dans les mains, ce beau et grand livre doré où dorment les sages paroles.
Elles sont toutes venues se poser en cercle autour de Marie et la Mère s’est avancée.
Une chaîne autour du cou et un livre dans les mains, ce beau et grand livre doré où dorment les sages paroles.
Marie me prend dans ses bras et j’entends murmurer à l’unisson les sages paroles.
Je devine que l’instant est rare et l’émotion intense.
Je lis cela dans les yeux de Marie. Son regard embrumé voudrait s’échapper par-delà les grands murs, prendre d’assaut plaines et montagnes, rivières et lacs, les langues éthérées du ciel. Frôler les étoiles pour atteindre le cœur des galaxies.
Je devine que l’instant est rare et l’émotion intense.
Je lis cela dans les yeux de Marie. Son regard embrumé voudrait s’échapper par-delà les grands murs, prendre d’assaut plaines et montagnes, rivières et lacs, les langues éthérées du ciel. Frôler les étoiles pour atteindre le cœur des galaxies.
La mère s’est penchée sur moi et trace des signes sur mon front mouillé.
La peau de Marie frissonne jusqu’au bout de ses bras qui tremblent légèrement.
Elle tente de se contrôler. Je devine son désarroi et l’immense tristesse qui s’empare d’elle.
Elle ne doit pas s’en faire, surtout. Rester sereine, douce et aimante. Pure comme la neige au premier matin d’hiver.
Ce n’est rien Marie, ce n’est rien.
Ce n’est qu’un jour de fête.
La peau de Marie frissonne jusqu’au bout de ses bras qui tremblent légèrement.
Elle tente de se contrôler. Je devine son désarroi et l’immense tristesse qui s’empare d’elle.
Elle ne doit pas s’en faire, surtout. Rester sereine, douce et aimante. Pure comme la neige au premier matin d’hiver.
Ce n’est rien Marie, ce n’est rien.
Ce n’est qu’un jour de fête.
Quelqu’un a allumé un grand feu de bois dans un coin du jardin.
Elles lèvent toutes les yeux au ciel tandis que Marie, livide, se rapproche un peu plus des flammes. De fins cheveux noirs strient la lumière et s’enfuient en volutes de fumée vers les hauteurs.
Marie m’embrasse et sous son humide baiser germe une nouvelle et atroce réalité.
Je ne reverrai plus jamais le fond de mon armoire !
Francis DENIS